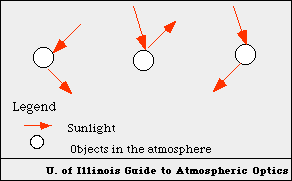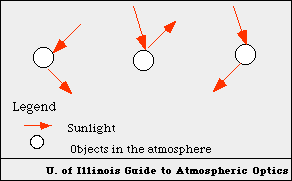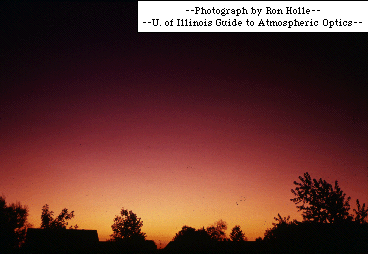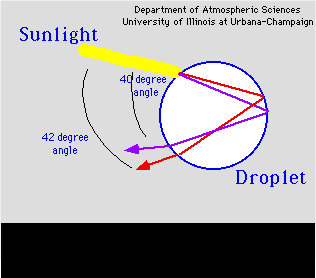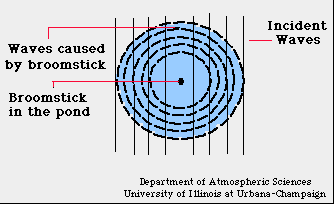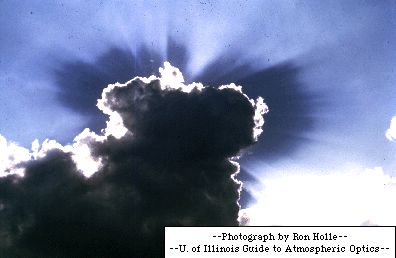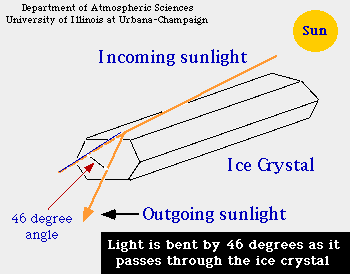Les couleurs du ciel
Les couleurs du ciel
ou pourquoi c'est si beau!!!
Quels magnifiques feux d'artifices que ces lumières qui surgissent dans le ciel... Le bleu du ciel... Le blanc des nuages... Le rouge du soleil couchant... L'atmosphère, ce filtre protecteur, impose des détours, pirouettes, déviations, diffractions, à la lumière solaire. Ceux-ci sont plus fréquents, près du sol... C'est d'ailleurs là que l'on retrouve la plupart des météores: arcs-en-ciel, halos, parhélies, rayons crépusculaires, ...
Un peu de physique des ondes... derrière ces beaux spectacles!
Les 3 phénomènes qui permettent de voir les couleurs du ciel sont:
- la diffusion (ce pourquoi le ciel est bleu);
- la réfraction (les arcs-en-ciel en sont le résultat);
- la diffraction (comme les anneaux colorés, les couronnes, ...)
Essayons tout d'abord de comprendre comment ça fonctionne...
Les rayons du soleil se propagent dans l'atmosphère sous formes d'ondes invisibles. Ces ondes rectilignes nous apparaîssent blanches, mais en fait elles sont un mélange de couleurs de la partie visible du spectre électromagnétique. Les couleurs (de la plus petite longueur d'onde à la plus longue) sont: violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Chaque couleur a une longueur d'onde bien spécifique qui la caractérise.
La diffusion
Quand les rayons solaires frappent l'atmosphère, selon la composition de celle-ci, chacune des longueurs d'onde est diffusée dans une direction distincte, donnant un effet visuel distinct.
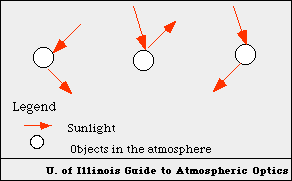
Par exemple, le ciel nous apparaît bleu parce que ce sont les longueurs d'onde les plus courtes qui sont le plus diffusées, ou diffusées le plus efficacement, par les molécules d'eau ou les poussières en suspension dans l'air. Evidemment, selon la région dans laquelle on se trouve, le bleu du ciel sera un peu différent. La proportion du jaune et du vert peut être amplifiée au-dessus des régions peuplées, à cause de la plus grande quantité de poussières dans l'air; le ciel apparaît alors plus clair qu'au-dessus de régions peu urbanisées.

Les couchers de soleil rougeâtres ou orangés sont aussi dûs à la diffusion de la lumière solaire.
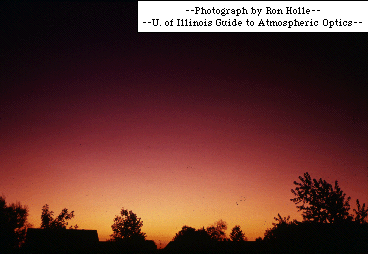
La réfraction
Par contre, les arcs-en-ciel, par exemple, sont causés par le phénomène de réfraction. Quel est-il? Lorsque la lumière traverse un milieu transparent, comme de l'eau ou du verre, elle est infléchie (ou réfractée), d'un petit angle. En fait, chacune des longueurs d'onde sont réfractées selon des angles différents; ceci provoque donc la séparation des couleurs du spectre (ou du prisme).

L'arc-en-ciel est formé lorsqu'un rayon lumineux traverse une molécule d'eau. Sa lumière est donc réfractée par les bords de la gouttelette et réfléchie par l'arrière de celle-ci. Les couleurs en ressortent séparées selon un angle légèrement différent.
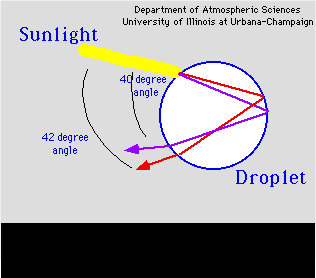
Le fait qu'on voit des bandes colorées distinctes est parce que chaque couleur ressort selon le même angle à partir de chacune des millions de gouttelettes d'eau présentes dans un nuage.

Une combinaison de réfraction et réflexion cause les halos et les parhélies.

La diffraction
Voici un patron de diffraction:
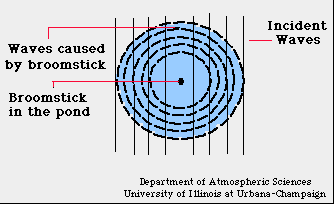
Ce dernier phénomène implique la déviation de la lumière sur le bord d'un objet, produisant des patrons de diffraction (évidemment, le nom l'indique!). On retrouve alors les couronnes, les anneaux colorés, ...
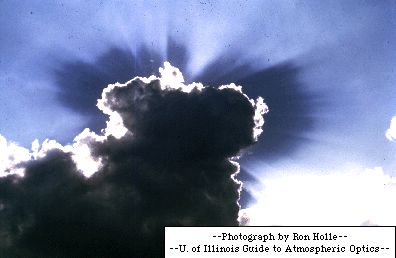
Différents milieux... différents effets!
Voici comment la lumière, solaire ou lunaire, réagit selon qu'elle se frappe sur différents "objets".
Description des cristaux...
La glace dans les nuages est responsable des effets optiques; il serait donc important d'en examiner la structure.
Les cristaux se forment directement à partir de la vapeur contenue dans l'air sursaturé, sans passer par une phase liquide. Selon la température de l'air et le degré de saturation de l'air en glace, le cristal sera différent. A cause des flocons, on sait que les cristaux sont hexagonaux. Ils ont 4 axes de symétrie: 3 coplanaires dont les intersections font des angles de 120 degrés et un axe perpendiculaire au plan des précédents axes.
4 formes cristallines sont importantes en optique météo: la plaquette hexagonale, la colonne (i.e. prisme à base hexagonale), la colonne surmontée d'un capuchon et la balle de révolver (i.e. un prisme surmonté d'une pyramide). On retrouve toujours 120 degrés entre 2 faces adjacentes du prisme, 0 ou 60 degrés entre 2 faces non-adjacentes du prisme et 90 degrés entre les bases et les faces latérales. Ce sont les faces qui forment entre elles 60 et 90 degrés qui sont responsables de presque tous les phénomènes de halo.
Les halos sont si différents parce que les cristaux de glace s'orientent différemment. Les minis cristaux (diamètre de moins de 20 micromètres) s'agitent continuellement; donc toutes les orientations sont possibles. Les cristaux dont la taille varie entre 50 et 500 micromètres sont maintenus dans des positions particulières par rapport à la direction de leur chute. Quand toutes les particules de glace sont du même type, alors elles s'alignent et forment ainsi la plupart des halos. Si les cristaux varient entre 0,5 et 3 millimètres, ils tournent alors sur eux-mêmes créant un autre type de halo.
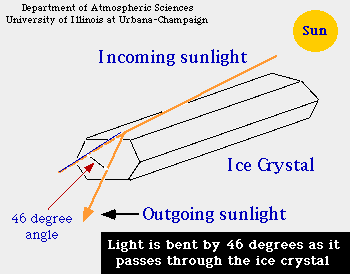
Les dictons associés aux couleurs du ciel...
Ciel rouge le soir, espoir; rouge le matin, chagrin. Dicton britannique connu sous différentes versions dans le monde entier.
En Chine, on dit: soir de braise et blanc matin c'est le jour du pélerin; matin carmin, ne te mets pas en chemin.
aurore boréale
optics
Copyright © 1997 Eve Christian, Tous droits réservés